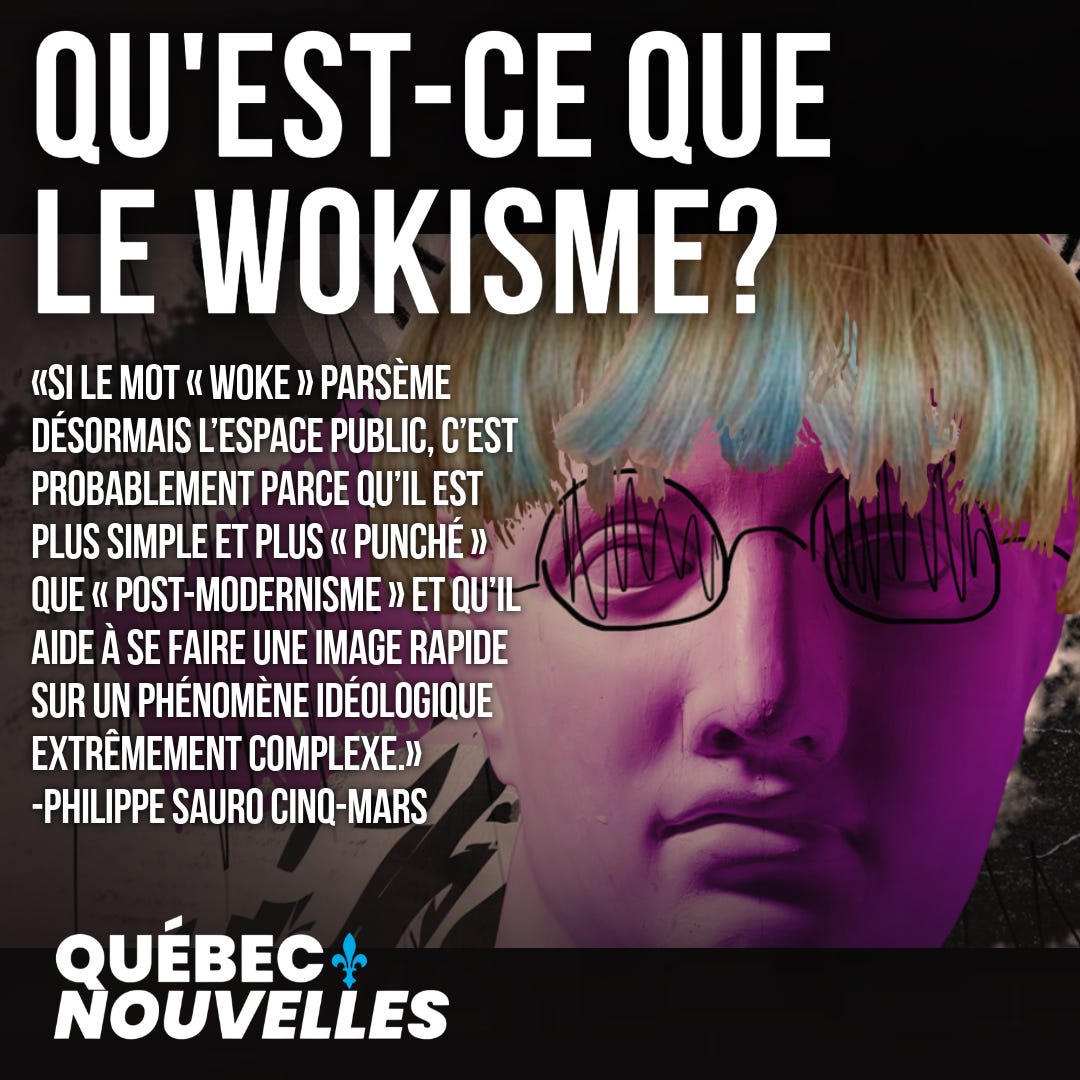Les propos du chef du Parti Québécois au sujet du wokisme ont engendré beaucoup de réactions dans les dernières semaines. Pour cette occasion, nous republions cet article de 2022 expliquant les tenants et aboutissants de cette idéologie.
Depuis quelque mois, le mot est devenu incontournable au Québec : « woke » – ou « éveillé » en anglais – est utilisé dans tous les débats politiques ou culturels soit pour décrire l’extrême-gauche, ou bien pour se moquer du terme jugé caricatural. Qu’en est-il vraiment? « Woke » n’est-il qu’une étiquette, qu’une raillerie, ou bien un courant politique réel que l’on pourrait qualifier de « wokisme »? Analyse.
Le terme woke, dans le sens d’être « éveillé » face au monde et à ses injustices, est utilisé dans les milieux militants américains depuis déjà quelques décennies, mais c’est entre 2012 et aujourd’hui qu’il a pris un nouveau sens et une expansion massive dans le langage courant[1]. Désormais, le mot n’est plus simplement un vague état d’esprit, mais un concept, une identité politique identifiable et associée aux mouvements pour la « justice sociale », aux « anti-racistes » et aux militants « intersectionnels » LGBTQ qui semblent se généraliser dans le champ gauche.
Ainsi, en apparence, le terme n’est qu’un mot fourre-tout pour désigner une constellation de mouvances de gauche qui n’ont pas réellement de liens entre-elles. Une simple manière de caricaturer et railler la gauche ou plus spécifiquement sa frange extrême et ses lubies étranges.
Cela dit, le terme n’est pas qu’une étiquette grossière ; il sert à définir un phénomène bien réel qui était déjà identifié par les universitaires, un nouveau paradigme de pensée dans la société occidentale dont découlent toutes les mouvances qualifiées de « woke » : le post-modernisme.
Postmodernité ; un simple constat
D’abord, le post-modernisme – une idéologie, dû au suffixe « isme » – découle de la postmodernité, qui n’est pour sa part qu’un constat.
Certains historiens, sociologues et politologues émettent donc la théorie que nous aurions quitté l’époque de la modernité – qui avait commencé à la fin du XVIIIe siècle avec les révolutions libérales et les révolutions industrielles – autour des années 1960-1970 et que nous serions entrés dans cette période transitoire, cette fin d’époque et début d’une autre dont le nom tarde à venir et qu’on se limite à qualifier de post-modernité, autrement dit, d’après-modernité.
Michel Maffesoli explique ce changement d’époque par trois grands piliers qui auraient changé autour de cette période[2]. Si la modernité pouvait être définie par le rationalisme, le progressisme et l’individualisme, la post-modernité, pour sa part, renouerait avec l’émotionnel, le temps présent et la communauté.
En effet, l’esprit rationnel, cartésien et calculateur, qui a fait les heures de gloire du triomphe technique et scientifique de l’Occident, est désormais vu comme froid, aliénant et insensible. Une recherche de sens ravive ainsi l’attrait pour les réalités subjectives et les exceptionnalismes ; le concept de vérités universelles s’affadit et laisse place à une posture plus empathique, plus compassionnelle, au risque d’aller à l’encontre de la raison.
Là où la modernité était un progressisme pur, une constante projection vers l’avant, vers un futur toujours meilleur, toujours en croissance, la post-modernité renoue avec le temps présent et l’importance des petits moments. C’est le fameux « Carpe Diem » popularisé par le film « La société des poètes disparus ». Et avec les enjeux environnementaux, la société postmoderne prône littéralement la décroissance ou en tout cas affiche un clair scepticisme face à la croissance infinie qui prévalait dans le progressisme classique.
Enfin, si la modernité était l’époque de l’individualisme et des droits universels, imposés à tous pour le bien de tous, la post modernité renoue avec le tribalisme et les communautés concurrentes. La solidarité communautaire l’emporte désormais sur les droits individuels ; on fait la promotion de l’exceptionnalisme et de la relativité des lois sur les différentes communautés et on juge l’individualisme moderne comme trop égocentrique. Les postmodernes doivent désormais faire allégeance au groupe, là où l’individualisme moderne les en libérait.
Post-modernisme ; une « sociologie de combat »
Mais ces renversements idéologiques ne sont à ce stade que des constats, des caractéristiques observables de notre époque, pas des mouvements politiques avec un agenda. Tout comme le caractère multiculturel du Canada – qui n’est qu’un constat irréfutable – se distingue du multiculturalisme, qui est une idéologie militante et une politique publique, il faut distinguer « postmodernité » et « post-modernisme ».
Le post-modernisme, embrasse le changement paradigmatique, le justifie et cherche à l’accentuer dans une dynamique militante, au mépris de l’époque antérieure qui existe pourtant encore.
Ce courant de pensée naît donc essentiellement comme un phénomène académique autour des années 1960-1970 sous la plume de sociologues comme Jacques Derrida ou Pierre Bourdieu qui s’intéressent au concept de « construits sociaux », c’est-à-dire de […]